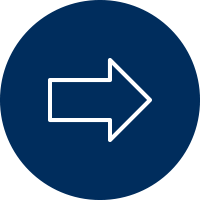http://www.lesclesdumoyenorient.fr/Les-Arabes-d-Iran-histoire-et-distinction-culturelle-1-2.html
LES ARABES D’IRAN : HISTOIRE ET DISTINCTION CULTURELLE (1/2)
Par Mathilde Rouxel
LES ARABES D’IRAN : HISTORIQUE DES SOULÈVEMENTS DES POPULATIONS ARABES SÉPARATISTES D’IRAN (2/2)
LES ARABES D’IRAN : HISTOIRE ET DISTINCTION CULTURELLE (1/2)
ARTICLE PUBLIÉ LE 22/09/2016
Par Mathilde RouxelDernières actualités
L’Iran est un pays composé de nombreuses minorités. Sur une population de 70 millions d’habitants, près de la moitié appartiennent à des groupes religieux ou ethniques différents. Ayant connu depuis ses origines de nombreuses invasions (grecques, arabes, turques, mongoles), l’ancien territoire perse est encore à ce jour le carrefour de nombreuses influences (1). Parmi ces groupes ethniques demeure une minorité arabe, présente sur le territoire depuis plus de douze siècles (2).
La plupart des communautés arabes d’Iran, qui composent entre 3 et 8% de la population générale du pays, résident le long des côtes du Golfe Persique, ou bien près de la frontière irakienne, au Sud de l’Iran. Cette dernière région est celle du Khūzestān, connue et désignée comme Ahvaz par les communautés arabes, présentée historiquement comme « Arabistan » par les populations locales (3). Cette région, située entre le Golfe persique, le Chatt al-Arab, les montagnes du Kurdistan iranien et les monts Bakhtiar de la chaîne du Zagros, est majoritairement peuplée d’Arabes chiites, issus de tribus venues de la péninsule arabique dès l’époque akkadienne, mais compte aussi des minorités sunnites et chrétiennes. Cette région est riche en ressources pétrolières, et se trouve très contrôlée par le pays (4).
Ces derniers mois, les groupes séparatistes ont renforcé leurs actions : le « Faucon d’Ahvaz », créé en 2015, a notamment mené en juin 2016 de violentes opérations contre le régime iranien, s’ancrant dans une longue tradition de résistance indépendantiste. Un retour sur l’histoire et la situation de ces minorités arabes d’Iran permet de comprendre et d’interroger leurs revendications.
La plupart des communautés arabes d’Iran, qui composent entre 3 et 8% de la population générale du pays, résident le long des côtes du Golfe Persique, ou bien près de la frontière irakienne, au Sud de l’Iran. Cette dernière région est celle du Khūzestān, connue et désignée comme Ahvaz par les communautés arabes, présentée historiquement comme « Arabistan » par les populations locales (3). Cette région, située entre le Golfe persique, le Chatt al-Arab, les montagnes du Kurdistan iranien et les monts Bakhtiar de la chaîne du Zagros, est majoritairement peuplée d’Arabes chiites, issus de tribus venues de la péninsule arabique dès l’époque akkadienne, mais compte aussi des minorités sunnites et chrétiennes. Cette région est riche en ressources pétrolières, et se trouve très contrôlée par le pays (4).
Ces derniers mois, les groupes séparatistes ont renforcé leurs actions : le « Faucon d’Ahvaz », créé en 2015, a notamment mené en juin 2016 de violentes opérations contre le régime iranien, s’ancrant dans une longue tradition de résistance indépendantiste. Un retour sur l’histoire et la situation de ces minorités arabes d’Iran permet de comprendre et d’interroger leurs revendications.
Les Arabes d’Iran : histoire de leur installation
Selon Gilles Munier, « dans l’antiquité la région appelée plus tard Arabistan fait partie de l’Elam et correspond à peu près à la Suziane. (…) Puissant royaume, l’Elam conquiert la Mésopotamie : la Babylonie et le royaume de Mari (Syrie). Il en est refoulé par Hammourabbi. Il s’effondre vers 613 avant JC, quand Assourbanipal prend Suze et l’annexe dans l’empire assyrien. Il est ensuite occupé par les Chaldéens, les Séleucides et les Parthes, puis englobé dans l’empire perse achéménide (550 à 331 avant J.C), puis perse sassanide (226-652 après J.C) » (5).
Suivant toujours Gilles Munier, la défaite perse à la bataille d’al-Qadissiyah face aux troupes musulmanes de Saab Ben Abi Waqass en 635 marque l’islamisation de la région d’Hormuzd Ardashir, rebaptisée Souk al-Ahwaz. Par la suite, ce qui fut l’Arabistan appartint aux empires omeyyade et abbasside. À cette période, les migrations arabes d’Irak sont massives et de nouvelles familles viennent sans cesse peupler la région méridionale du Golfe persique. Selon certains, le califat abbasside aurait permis l’établissement de dynasties chiites locales en Iran, qui auraient induit ce mouvement d’immigration des Arabes chiites réfugiés (6). Après la chute des Abbassides, le flux se fait ainsi moins soutenu, mais ne s’arrête pas ; la région demeure plus ou moins indépendante des shahs safavides, « notamment au XVe et XVIIe siècle avec l’Émirat arabe de Musha’sha, dont la capitale était Howayisa au nord-ouest de la région » (7).
Le XVIIe siècle est marqué par l’arrivée massive de nouvelles tribus venues du désert du Nedj d’Arabie. Cheikh Salman, chef de la tribu des Banu Ka’b installée au sud-ouest du fleuve Karoun, conquiert peu à peu les provinces jusqu’à Bassora en créant une flotte puissante, qui oblige le Pacha Ottoman de Bagdad à recourir à l’aide de la Compagnie des Indes Orientales, en vain. La création du port de Mohammara (« la rouge ») à l’embouchure du Karoun par la tribu des Banu Ka’b attise les convoitises. En 1856, durant la guerre anglo-persane, le Khūzestān fut un enjeu de poids. Les forces navales entrèrent dans la ville d’Herat par la rivière du Karoun en direction d’Ahvaz. Elles furent néanmoins repoussées par les Perses.
Bien que la région ait toujours appartenu au territoire perse, la partie ouest du Khūzestān fonctionna durant les deux décennies qui précédèrent 1925 de façon autonome sous le nom d’Arabistan. La partie est était dirigée par les khans Bakhtiari (perses). En 1922 naquit à l’ouest le mouvement des séparatistes arabes du Khūzestān, destiné à défendre et à libérer l’est de la région de l’« occupation perse ». Cette révolte, menée par le Cheikh Khaz’al de Mohammara, fut réprimée en 1924 par le régime Pahlavi, arrivé récemment au pouvoir. L’émirat d’Arabistan fut dissout par le gouvernement de Reza Khan, qui centralisa l’État perse en 1925. L’Arabistan devient le Khūzestān en 1936 (8). Proche de l’Allemagne nazie, Reza Khan fut remplacé en août 1941 par son fils Mohamed. De nouvelles révoltes éclatèrent au Khūzestān entre 1943 et 1945, qui furent réprimées dans le sang (9).
Le Khūzestān fut par ailleurs l’enjeu principal de Saddam Hussein dans la guerre Iran-Irak. Longeant la frontière avec l’Irak, la région s’est trouvée particulièrement ciblée et centralisait les tensions entre les deux pays. L’Iran a conservé le contrôle du territoire arabophone et l’armée irakienne se retira en 1988.
Aujourd’hui, le Khūzestān compte plus de quatre millions d’habitants. Plus de 70% de la population arabe d’Iran est urbanisée, mais il existe encore une population rurale et une population nomade au Khūzestān.
Les Arabes d’Iran aujourd’hui
Il existe, dans le Khūzestān, un dialecte arabe parlé par sa population. Cet « arabe Khūzestāni », proche des dialectes arabes iraquiens parlés le long de la frontière qui sépare l’Iran de l’Irak, est très influencé par la langue perse, ce qui le rend difficile de compréhension pour les Arabes issus d’autres régions.
L’enseignement de l’arabe Khūzestāni est interdit par le gouvernement iranien. Les classes proposent, pour une bonne compréhension du Coran, l’enseignement de l’arabe classique et de l’arabe moderne standard, utilisé pour la presse et constitutionnellement imposé dans les classes de secondaire. En n’autorisant aucun enseignement en arabe Khūzestāni, le régime iranien laisse une grande part des populations arabes d’Iran à l’écart de l’instruction : l’on note une corrélation entre ce fait et le très faible taux d’alphabétisation de la région, notamment en ce qui concerne les femmes vivant en zone rurale (10).
L’enseignement de l’arabe Khūzestāni est interdit par le gouvernement iranien. Les classes proposent, pour une bonne compréhension du Coran, l’enseignement de l’arabe classique et de l’arabe moderne standard, utilisé pour la presse et constitutionnellement imposé dans les classes de secondaire. En n’autorisant aucun enseignement en arabe Khūzestāni, le régime iranien laisse une grande part des populations arabes d’Iran à l’écart de l’instruction : l’on note une corrélation entre ce fait et le très faible taux d’alphabétisation de la région, notamment en ce qui concerne les femmes vivant en zone rurale (10).
En conséquence, cet usage d’un dialecte distinct du persan exclut cette minorité, qui se regroupe, par-delà les différences de conversion (musulmans sunnites, chiites, chrétiens…) pour présenter une unité ethnique, « arabe », contre les discriminations dont elle est victime. Amnesty International note en effet que bien que le « total respect » envers les minorités sunnites d’Iran soit garanti par la constitution, les sunnites iraniens souffrent manifestement de « persécutions ethniques et religieuses » (11).
Cette répression n’est pas seulement culturelle, elle est aussi conjoncturelle, et s’applique à l’ensemble des Khūzestāni : au sein de la société iranienne, bien que la région soit l’une des plus riches en ressources de tout le territoire iranien, les Arabes d’Iran sont de loin les populations les plus confrontées au chômage. En juin 2016, le ministre iranien de l’Intérieur Abdolreza Rahmani Fazli a été lui-même forcé de reconnaître qu’un « taux de plus de 50 ou 60% de chômage peut causer des dommages sociaux irréparables » (12) ; en outre, une absence d’amélioration de la situation générale de la région est une menace pour la sécurité du régime lui-même. Les conditions sanitaires sont par ailleurs les plus dangereuses d’Iran, l’air se trouvant fortement pollué par les usines pétrochimiques qui dominent l’ensemble du territoire.
Lire la partie 2 : Les Arabes d’Iran, une minorité opprimée et révoltée : historique des soulèvements des populations arabes séparatistes d’Iran (2/2)
A lire également : Nation et minorités en Iran : face au fait minoritaire, quelle réponse institutionnelle ?
Notes :
(1) Voir Mohammed-Reza Djalili, Géopolitique de l’Iran, éditions Complexe, 2005.
(2) Minorities at Risk, « Assessment for Arab in Iran », disponible en ligne : http://www.mar.umd.edu/assessment.asp?groupId=63009
(3) Jean Calmard, article “Khouzistan”, Encyclopedia Universalis, disponible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/khouzistan/
(4) Voir le rapport d’Amnesty International du 17 Mai 2006, « Defending Minority Rights : The Ahwazi Arabs », archive téléchargeable :https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=mde13/056/2006&language=en
(5) Gilles Munier, “La ‘libération’ de l’Arabistan”, AFI-Flash, n°59, 11/06/2006, disponible en ligne : http://www.france-irak-actualite.com/page-2512744.html
(6) Helâli, Nâser, « Ghowm-e bozorg-e arab dar Irân » (La grande ethnie arabe en Iran), cité par Hamideh Haghighatmanesh, « Les Arabes d’Iran », La Revue de Téhéran, n°104, juillet 2014, disponible en ligne : http://www.teheran.ir/spip.php?article1929#nb1
(7) Ibid.
(8) Journal of Middle Eastern studies, Vol. 25, n°3 (Août 1993), pp. 541-543.
(9) Gilles Munier, op. cit.
(10) Amnesty International, “Iran : Defending Minority Rights : The Ahwazi Arabs”, op. cit.
(11) Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en
(12) Propos cité dans l’article de Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », op. cit.
(2) Minorities at Risk, « Assessment for Arab in Iran », disponible en ligne : http://www.mar.umd.edu/assessment.asp?groupId=63009
(3) Jean Calmard, article “Khouzistan”, Encyclopedia Universalis, disponible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/khouzistan/
(4) Voir le rapport d’Amnesty International du 17 Mai 2006, « Defending Minority Rights : The Ahwazi Arabs », archive téléchargeable :https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=mde13/056/2006&language=en
(5) Gilles Munier, “La ‘libération’ de l’Arabistan”, AFI-Flash, n°59, 11/06/2006, disponible en ligne : http://www.france-irak-actualite.com/page-2512744.html
(6) Helâli, Nâser, « Ghowm-e bozorg-e arab dar Irân » (La grande ethnie arabe en Iran), cité par Hamideh Haghighatmanesh, « Les Arabes d’Iran », La Revue de Téhéran, n°104, juillet 2014, disponible en ligne : http://www.teheran.ir/spip.php?article1929#nb1
(7) Ibid.
(8) Journal of Middle Eastern studies, Vol. 25, n°3 (Août 1993), pp. 541-543.
(9) Gilles Munier, op. cit.
(10) Amnesty International, “Iran : Defending Minority Rights : The Ahwazi Arabs”, op. cit.
(11) Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en
(12) Propos cité dans l’article de Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », op. cit.
===========
β' μέρος
LES ARABES D’IRAN : HISTORIQUE DES SOULÈVEMENTS DES POPULATIONS ARABES SÉPARATISTES D’IRAN (2/2)
ARTICLE PUBLIÉ LE 26/09/2016
Par Mathilde Rouxel
Lire la partie 1 : Les Arabes d’Iran : histoire et distinction culturelle (1/2)
De la disparition de l’Arabistan en 1925 à la révolution de 1979
Les violences séparatistes existent depuis la prise militaire du Khūzestān Ouest, alors indépendante et baptisée « Arabistan », par les troupes pahlavis du gouvernement de Reza Khan. La fin de l’autonomie de l’Arabistan est arrivée dans un contexte de volonté de centralisation de la part du régime Pahlavi ; ce dernier combattait déjà des groupes de résistance séparatistes du Khūzestān qui tentait de « libérer » la partie Est de la région de l’occupation et du gouvernement des Bakhtiari. Les révoltes se poursuivent, et des mouvements de violence se manifestent en 1925, puis en 1928 et en 1940 (1). Comme le précise Philippe Rondot dans un article daté de 1980, « à la différence des Kurdes, partagés par les frontières et soumis à des pouvoirs centraux différents, et de ce fait très vulnérables, les habitants de l’Arabistan pouvaient être tentés de trouver, chez les États arabes proches et indépendants du Golfe, un appui aux revendications autonomistes qu’ils ne manquèrent jamais de manifester » (2). Un mémorandum est adressé à la Ligue Arabe en 1945, mais personne n’en tient compte. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le parti Al-Saada, fondé à Mohammar, réclame auprès du régime iranien l’indépendance du Khūzestān. La présence du parti communiste (Tudeh) dans la région permit au régime de justifier de violentes attaques sur le territoire arabophone, ce qui étouffa les revendications séparatistes. La plupart des partis indépendantistes ou autonomistes voient le jour à partir de la deuxième moitié des années 1950 : le Front de Libération de l’Arabistan (1956, devenu en 1967 le Front de Libération d’Al-Ahvaz) proclame que seule « une révolution totale » par « la lutte armée » peut permettre la libération de la région ; le Front National de Libération de l’Arabistan et du Golfe arabe demande, pour sa part, un rattachement à l’Irak (3). Laissés en reste de la Révolution de 1979, les activistes du groupe sécessionniste « les Arabes Ahvazis » ont rapidement mené des actions : par-delà la révolte de 1979 au Khūzestān, étouffée par les forces de sécurité gouvernementale et qui fit plus d’une centaine de morts dans les deux camps, ils menèrent des actions contre le pouvoir iranien, tout en choisissant de rester pleinement indépendants.
La poursuite des idéaux indépendantistes de 1980 à 2011
En avril-mai 1980, un groupe de six hommes armés appartenant au Front Démocratique Révolutionnaire pour la Libération de l’Arabistan (FDRLA) attaquèrent l’ambassade d’Iran à Londres et prirent en otages vingt-six personnes. Il s’agit de l’opération Nimrod, qui fut désamorcée par la police britannique mais qui marqua dans les esprits les revendications indépendantistes des minorités arabes d’Iran.
À partir du mois de septembre de la même année, la région fut d’ailleurs le théâtre où se jouaient les principaux enjeux de la guerre entre l’Iran et l’Irak, qui dura de 1980 à 1988. En effet, la frontière qui séparait à cet endroit les deux États était naturelle : elle était délimitée par le Chatt el-Arab, ou « rivière des Arabes », fleuve formé par la réunion du Tigre et de l’Euphrate et qui se jette dans le golfe Persique, suivant sur 90km la frontière Iran-Irak. Comme le note à nouveau, dans un autre article, l’historien Philippe Rondot, le Chatt el-Arab est depuis toujours une frontière culturelle et politique entre deux puissances impériales (ottomane et perse), mais aussi entre deux monde (l’un arabe, l’autre aryen) et deux légitimités de l’islam (sunnisme et chiisme). De nouvelles frontières furent déterminées en 1975 à Alger à l’initiative de l’Iran, décidant la division du Chatt el-Arab le long de la ligne fluviale médiane. La contestation de cet accord par l’Irak enclencha le conflit Iran-Irak qui se poursuivit jusqu’en 1988 (4). Au vu des velléités indépendantistes de cette aire géographique, les Irakiens crurent que la bataille du Khūzestān serait perçue par les populations comme une « guerre de libération » (5) ; l’accueil des troupes irakiennes ne fut toutefois pas unanime. La riposte du régime iranien se fit de surcroît plus radicale que prévue et le territoire arabophone demeura sous domination de l’Iran. Le cessez-le-feu et le retrait des troupes irakiennes d’Iran marquèrent, pour un temps, la fin des rêves nationalistes des arabes d’Al-Ahvaz.
Au milieu des années 2000 cependant, des vagues de révolte surgirent à nouveau, en réponse à une lettre d’un conseiller du président de la République iranienne préconisant le déplacement des populations arabes et le remplacement des noms arabes par des noms persans. Selon Amnesty International, « les tensions sont de plus en plus vives au sein de la population arabe d’Iran depuis avril 2005, mois pendant lequel de très nombreuses personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées au cours de manifestations » (6) : en effet, des attaques revendiquées ont repris en 2005, dans la continuité des émeutes rigoureusement réprimées (cinq morts en avril 2005, quatre explosions à Ahvaz en juin 2005, six bombes tuant six personnes en octobre 2005, etc.). La réaction des forces du régime face à ces grandes manifestations fut condamnée par la communauté internationale, notamment après l’exécution de trente-sept Arabes après des procès jugés « inéquitables » par Amnesty International (7). Les attaques, perpétrées pour la plupart avant les élections présidentielles de 2005, étaient alors revendiquées par les Brigades des martyrs révolutionnaires Ahwazi, mais la résistance fut rapidement suivie plus largement : en mars 2006, une station de radiotélévision clandestine, Al-Ahwaz TV (8), appelle les Arabes de Khūzestān à la révolte.
L’onde de choc des « printemps arabes » et la résistance contemporaine
En 2011, suivant les mouvements de révolte enclenchés dans de nombreux pays arabes, de fortes mobilisations arabophones sont réprimées par le régime iranien dans la ville d’Ahvaz. Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix en 2003, écrivait au Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme à l’ONU Navi Pillay, que « le 16 avril 2011, un groupe d’Iraniens sunnites arabophones, de la ville d’Ahvaz, province de Khuzestan, située dans le sud de l’Iran, ont manifesté leur détresse à travers des manifestations pacifiques. Malheureusement, ils ont été violemment réprimés par le gouvernement » (9). Devant ces événements, Amnesty International expliquait alors que « les manifestations portent sur des griefs de longue date, à savoir la discrimination institutionnalisée et le refus de droits économiques et culturels » (10).
En 2015, en prévision du dixième anniversaire des grandes manifestations contre Téhéran, au moins soixante-dix-huit personnes furent arrêtées. Plutôt que de les étouffer, ceci alimenta au contraire les manifestations anti-régime : en février, les Ahvazi descendaient à nouveau dans la rue pour faire valoir leurs droits.
Très récemment, un nouveau groupe indépendantiste né en 2015, « les Faucons d’Ahvaz », a revendiqué l’attaque d’une usine pétrochimique dans le complexe de Bou-Ali-Sina, survenue à Bandar-E-Mahshahr au Khūzestān début juin 2016 (11). Dans le communiqué qui justifiait l’attaque, le groupe appelait à nouveau à la résistance contre l’« occupation », prétendant que « la jeunesse arabe d’Ahvaz vit avec les constantes arrestations, expulsions et exécutions. Ces atteintes de l’ennemi perse (…) ne nous ont laissé d’autre choix que de lancer une riposte pénible et cataclysmique » (12).
Très récemment, un nouveau groupe indépendantiste né en 2015, « les Faucons d’Ahvaz », a revendiqué l’attaque d’une usine pétrochimique dans le complexe de Bou-Ali-Sina, survenue à Bandar-E-Mahshahr au Khūzestān début juin 2016 (11). Dans le communiqué qui justifiait l’attaque, le groupe appelait à nouveau à la résistance contre l’« occupation », prétendant que « la jeunesse arabe d’Ahvaz vit avec les constantes arrestations, expulsions et exécutions. Ces atteintes de l’ennemi perse (…) ne nous ont laissé d’autre choix que de lancer une riposte pénible et cataclysmique » (12).
En cette période de crise régionale, à l’heure où la République islamique garde les yeux rivés à la fois sur les États-Unis et sur la Syrie, il semble que la question arabe en Iran est loin d’être réglée et que la résistance n’est pas prête à s’apaiser.
Notes :
(1) Gilles Munier, “La ‘libération’ de l’Arabistan”, AFI-Flash, n°59, 11/06/2006, disponible en ligne : http://www.france-irak-actualite.com/page-2512744.html
(2) Philippe Rondot, « La guerre du Chatt al-Arab : les raisons de l’Irak », Politique étrangère, n°4, 1984, pp.867-879, disponible en ligne :http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1980_num_45_4_3004
(3) Voir Paul Balta (dir.), Le Conflit Iran-Irak, Notes et études documentaires, n°4889, 1989.
(4) Philippe Rondot, « Iran-Irak (Guerre) », Encyclopedia Universalis, disponible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/irak-iran-guerre/
(5) Philippe Rondot, « La guerre du Chatt al-Arab : les raisons de l’Irak », op. cit.
(6) Amnesty International, « Plein feux sur les Actions Urgentes : La minorité arabe d’Iran », mai 2006, en ligne, op. cit.
(7) Voir Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en
(8) Voir le site du média en ligne : http://www.ahwazmedia.tv
(9) Propos repris dans Armin Arefi, « Soulèvements arabes en Iran », Blog de Le Monde, 20/04/2011,http://iran.blog.lemonde.fr/2011/04/20/soulevements-arabes-en-iran/
(10) Cité par Armin Arefi, op. cit.
(11) Michael Segali, « Le renforcement de l’opposition ethnique en Iran », Centre des affaires publiques et de l’Etat, http://jcpa-lecape.org/le-renforcement-de-lopposition-ethnique-en-iran/
(12) Rapporté par Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran »,Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en
(2) Philippe Rondot, « La guerre du Chatt al-Arab : les raisons de l’Irak », Politique étrangère, n°4, 1984, pp.867-879, disponible en ligne :http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1980_num_45_4_3004
(3) Voir Paul Balta (dir.), Le Conflit Iran-Irak, Notes et études documentaires, n°4889, 1989.
(4) Philippe Rondot, « Iran-Irak (Guerre) », Encyclopedia Universalis, disponible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/irak-iran-guerre/
(5) Philippe Rondot, « La guerre du Chatt al-Arab : les raisons de l’Irak », op. cit.
(6) Amnesty International, « Plein feux sur les Actions Urgentes : La minorité arabe d’Iran », mai 2006, en ligne, op. cit.
(7) Voir Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran », Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en
(8) Voir le site du média en ligne : http://www.ahwazmedia.tv
(9) Propos repris dans Armin Arefi, « Soulèvements arabes en Iran », Blog de Le Monde, 20/04/2011,http://iran.blog.lemonde.fr/2011/04/20/soulevements-arabes-en-iran/
(10) Cité par Armin Arefi, op. cit.
(11) Michael Segali, « Le renforcement de l’opposition ethnique en Iran », Centre des affaires publiques et de l’Etat, http://jcpa-lecape.org/le-renforcement-de-lopposition-ethnique-en-iran/
(12) Rapporté par Middle East Eye, « Les séparatistes arabes revendiquent une attaque contre des installations pétrolières en Iran »,Middle East Eye, 11/07/2016, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/des-s-paratistes-arabes-revendiquent-une-attaque-contre-des-installations-p-troli-res-en